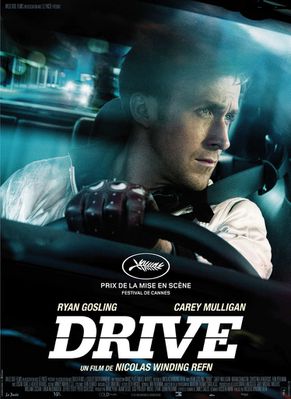Voyage en Italie
Mini cycle « Fétichisme »
Face à l'un des films les plus amples du cinéma, tentons de voir où le fétichisme influe sur la perception même du ballet Bardot/Piccoli.
L'histoire aura voulu que le grand public ne retienne du Mépris que le « tu les aimes mes fesses ? » de Brigitte Bardot. Une image d’Épinal plus connue pour sa réplique que pour sa mise en scène sur l'ensemble de la séquence. Un instant mythique emblématique pour le plus célèbre film de Jean-Luc Godard. Il n'est pas question ici d'essayer d'être exhaustif sur ce monument dont tout a déjà été dit et écrit. Néanmoins, dans le cadre du mini-cycle sur le fétichisme, il apparaît indispensable de revenir sur l'articulation de ce dernier dans le Mépris, élément secondaire mais indispensable. Dans la définition du mot, il est possible d'y lire « vénération outrée, superstitieuse pour quelque chose ou quelqu'un ». N'est-il pas dans Le Mépris fétichisme plus total pour l'icône Bardot, pour le cinéma, pour l'art en général ? Le générique parlé en est l'emblème. Raconter en voix off appelle au conte. Godard en déclame un, version hybride de Voyage en Italie de Rossellini et de l'Odyssée d'Homère*.
Qu'est ce qui fait que ce fétichisme, en dépit de l'image caricaturée du film, survit encore ? L'humour vient désamorcer par bribes la tragédie grecque. Paul passe par une porte pas encore vitrée et Camille traite d’âne son mari à travers une blague qui ressemble... à un conte. Tiens donc. Le recul inhérent montre le regard amusé de Godard. Il dessine au premier plan le ballet macabre le plus lumineux qui soit, à la chorégraphie précise. Le morceau central, dans l'appartement romain, synthétise parfaitement le va-et-vient continu du couple. Le pont entre Homère et Rossellini devient évident. Paul et Camille arpentent les sillons de leur auto-destruction avec le même acharnement que le duo Bergman/ Sanders. Les statues grecques omniprésentes et l'idée d'un séjour professionnel à Capri laissent imaginer une dispute similaire entre Ulysse/ Pénélope.
L’attachement artistique de Godard va jusqu'à réinventer le livre d'Homère. Et si Ulysse ne partait en guerre que parce que sa femme ne veut plus de lui ? Cette théorie oublie l'acte final. Les retrouvailles, possibles grâce à un ultime sacrifice (au sens courant), font de l'étreinte finale un grand moment de tendresse. Le Mépris se limite à suivre le délitement. Il n'y aura pas de retrouvailles puisque Camille meurt. L'amour inconditionnel de l'art sert ici à rejouer l'une des grandes figures de la tragédie. Non pas au sens de fin inéluctable mais dans la trajectoire rectiligne de deux personnages bornés dans leurs postures. Tout l'attrait fétichiste vient de la capacité qu'a Godard à envelopper cela d'un cocon coloré. Quand il filme Bardot nue au début, il enlève ses filtres rouges et bleus précisément quand il contemple les courbes lisses de ses fesses. Le lancer délicat de la jambe de « B.B. » s’apparente à la perfection du modèle grecque, le mouvement en plus. La statue de l'appartement romain en est une preuve. La femme de bronze y est très belle, bien que le regard tourné vers le bas crispe la grâce.
Le lien entre les deux personnages et les héros grecques est encore plus évident avec les images de dieux aux yeux colorés. Le réalisateur sait que le gris des sculptures antiques ne cache les vraies couleurs qu'à la faveur des ravages du temps. Ce même temps qui ravage le couple. A travers le soin de cinéaste, Godard renoue avec les teintes antiques comme il renoue avec la ferveur de l'amour présent. Il y a une fascination iconodoule qui a tout à voir avec l'amour des hellènes pour leurs divinités incarnées. Par le prisme du cinéma et la présence de Fritz Lang, c'est comme si Athéna venait influer sur le cours de la bataille. Aphrodite, déesse de l'amour n'existe jamais. Godard lui préfère le tempétueux Poséidon, démiurge terrifiant qui déchaîne les mers. La guerre de Troie de Paul aura bien lieu. Sauf qu'ici, le dieu des mers gagne son combat. Dans un ultime regard au moment de monter dans un hors-bord, Camille appelle Paul à ne pas la laisser tomber. Le Mépris focalise son attention sur ce moment précis où l'amour s'en va. Un peu comme un turning-point rend le retour en arrière impossible pour les héros de cinéma.**
Fritz Lang désincarne le fétichisme, justifie le fait qu'il est impossible de réduire le film à cela. Sa présence même sert de trait-d'union conscient entre le romanesque et le réel (ici le septième art). Il est une sorte de messager des dieux. La beauté du jeu avec la perruque noire n'est qu'un prolongement du thème du double si cher au cinéaste allemand. D'ailleurs, Bardot l'enfile pile quand elle songe à avouer que son amour a disparu. Une poétique qui inspirera Lynch dans Mulholland Drive. Bardot est une poupée manipulée par le maître de la Nouvelle Vague. Il ne lui laisse aucune liberté. Il en fait un objet de fantasme étriqué. Son visage ne permet pas de lire les inflexions de tempérament. Les réactions illisibles de Camille troublent le désir autant qu'il l'amplifie. Si l'admiration sans borne pour les courbes de la belle laisse place au fantasme, celui-ci est contrarié. Bardot se meut en femme de légende. Elle atteint le statut d'icône opaque.
Un Être inaccessible même pour son mari. Camille n'est pas que le fruit d'un amour fusionnel. Le fétichisme du film sert à lier le spectateur à Paul, personnage masochiste. Chaque scène consiste à l'esseuler un peu plus. Sa souffrance le pousse à insister dans cette voie. L'asynchrone mouvement de Piccoli, tout en rupture de rythme devant l'avancée entêtée de Camille, montre deux personnes aux trajectoires qui ne peuvent plus se rejoindre. Un peu comme si le ballet n'arrivait plus à caler ses deux danseurs sur le même tempo. La vitesse de fuite de Camille dépasse Paul. Même lorsqu'il lit la lettre d'adieu de son amazone, il décrypte lentement les dernières traces vénéneuses d'une femme prise dans une ultime étreinte. Celle, violente, d'un camion qui déchire la peau lisse de l'icône fragile. Dès lors, Bardot deviendra un idéal de blondeur -fétichisme primaire- quand le film dans sa globalité a su dépasser ce qui aurait pu n'être qu'un objet de coquetterie.
Le Mépris, de Jean-Luc Godard, avec Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Fritz Lang (Fra., 1h40, 1963)
* l'Odyssée était d'ailleurs un conte transmit oralement de génération en génération avant qu'Homère ne se décide de le mettre à l'écrit.
** Cette considération peut paraître étrange tant l'existence même du turning-point, élément de scénariste par excellence, ne sied pas à la personnalité de Godard, hostile au cinéma de scénariste. Dans Le Mépris, il détourne son utilisation.
La bande-annonce de Le Mépris :


















































 Pas Mal.
Pas Mal.